Diphtérie - Symptômes, causes et traitement

Sommaire
La diphtérie est généralement causée par la bactérie C. diphtheriae. Celle-ci produit une toxine qui provoque divers symptômes chez l’homme, tels qu’un mal de gorge, de la toux et un enrouement. Dans de rares cas graves, des difficultés respiratoires potentiellement mortelles ou une propagation des bactéries dans le sang peuvent survenir, entraînant parfois des arythmies cardiaques. La maladie est généralement traitée avec des antibiotiques et des antitoxines. Il existe également un vaccin capable de prévenir, dans la plupart des cas, l’évolution sévère de la maladie.
Qu’est-ce que la diphtérie ?
La diphtérie est une maladie infectieuse causée par des corynébactéries, un type spécifique de bactérie. Il existe deux types de diphtérie :
1. Diphtérie respiratoire
-
- : les voies respiratoires supérieures sont alors particulièrement touchées. On observe des symptômes pseudogrippaux. La cause principale est une infection à
Corynebacterium diphtheriae
-
- (C. diphtheriae).
2. Diphtérie cutanée : la diphtérie cutanée survient lorsque la bactérie pénètre dans le corps par de petites lésions cutanées superficielles, telles que des piqûres d’insectes. C’est pourquoi on parle souvent de diphtérie par plaie. La diphtérie cutanée est généralement causée par les bactéries C. ulcerans et C. pseudotuberculosis. Cette forme de diphtérie est appelée zoonose, car les agents pathogènes peuvent être transmis des animaux aux humains. Il est donc possible d’être infecté par un chat ou un chien de compagnie.
Les bactéries pénètrent parfois dans la circulation sanguine et se propagent dans tout le corps. On parle alors de diphtérie toxique.
Les corynébactéries sont très répandues, et de petits pôles d’éclosion continuent d’apparaître dans le monde, mais ceci se produit principalement dans les zones subtropicales et dans les pays où les normes d’hygiène sont moins strictes.
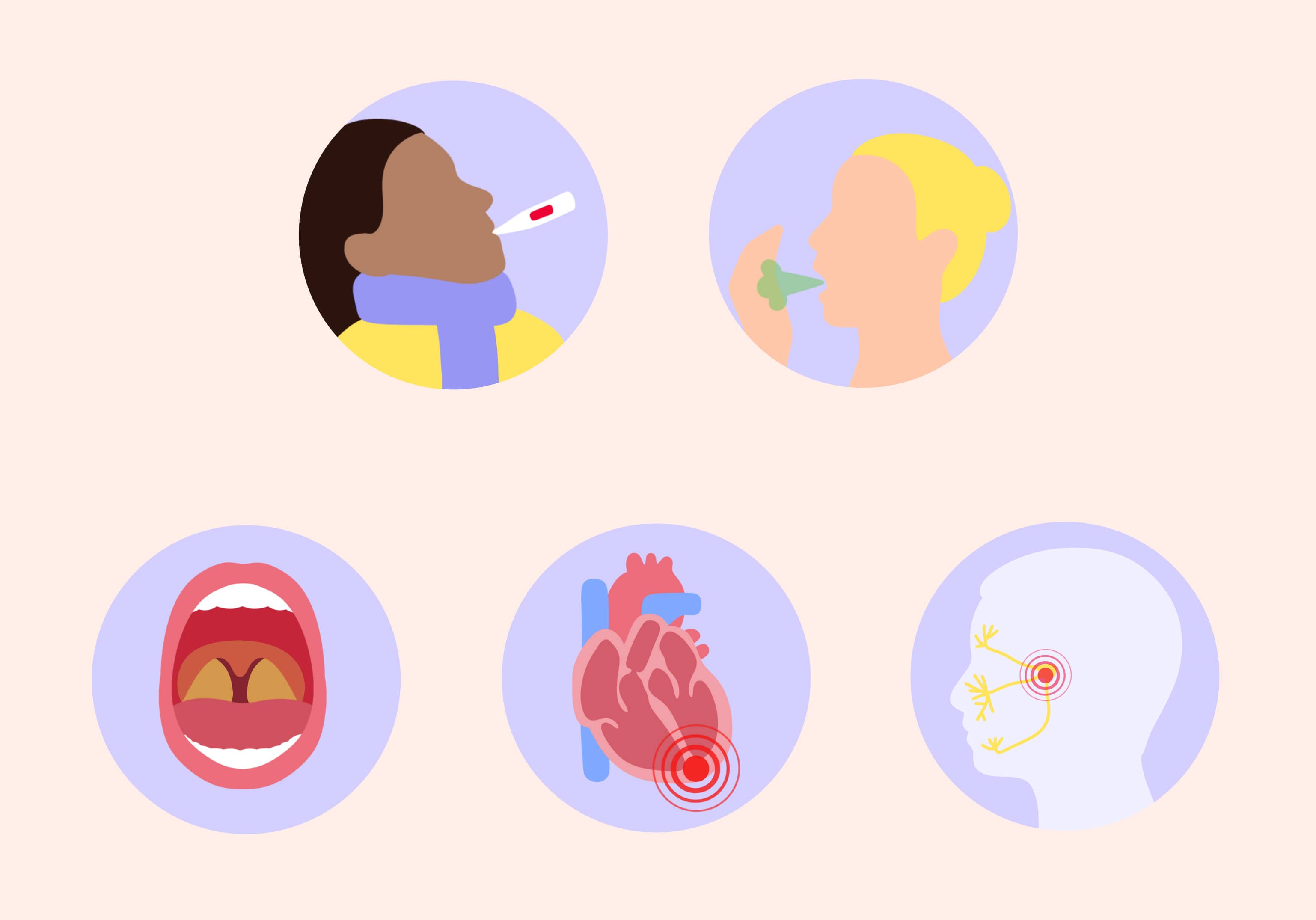
Au début de la maladie, les symptômes sont généralement similaires à ceux d’un rhume ou d’une grippe. Les troubles potentiels sont :
- mal de gorge (amygdalite) ;
- difficultés à avaler ;
- fièvre ;
- enrouement (diphtérie pharyngée) ;
- toux (toux du croup) ;
- mauvaise haleine.
Dans de nombreux cas, un dépôt gris-brunâtre se développe dans le pharynx au niveau des amygdales - connu dans les milieux professionnels sous le nom de pseudomembrane. C’est pourquoi la diphtérie est aussi parfois appelée bronzage du cou. La plaque en question a généralement tendance à saigner lorsque l’on essaie de la gratter. En raison du potentiel d’augmentation de l’inflammation, il est plus sûr de consulter un médecin plutôt que de tenter de retirer la plaque soi-même.
La diphtérie s’accompagne parfois de complications graves pouvant mettre la vie en danger ou entraîner un coma. Celles-ci incluent par exemple une inflammation du muscle cardiaque (myocardite) et des arythmies cardiaques, qui déclenchent dans de rares cas un choc cardiogénique.
Dans les cas les plus graves, une inflammation nerveuse (névrite) peut également se développer, entraînant éventuellement une paralysie de la tête ou du visage. Les muscles respiratoires peuvent également être touchés, ce qui rend la respiration de certains patients plus difficile. Il est alors important de mettre en place un traitement médical intensif immédiat. Sans contre-mesures, les difficultés respiratoires peuvent entraîner la mort par asphyxie. C’est pourquoi la diphtérie est également connue sous le nom de « l’ange étrangleur d’enfants ».
Comment se développe la diphtérie ?
Les bactéries diphtériques se propagent généralement par gouttelettes respiratoires. Ceci signifie que l’infection se produit lorsque les particules sont inhalées. Mais une infection par frottis peut elle aussi déclencher la maladie. Ainsi, lorsqu’une personne infectée touche des objets, les bactéries s’y collent. Toute autre personne qui touche les mêmes objets risque donc d’absorber ces bactéries.
En cas de diphtérie cutanée, les agents pathogènes sont souvent transmis lorsque la plaie ou sa sécrétion est touchée.
Toute personne infectée par les agents pathogènes ressent généralement les premiers symptômes après deux à cinq jours (période d’incubation). Si ceux-ci ne sont pas traités, les agents pathogènes restent généralement détectables via les sécrétions et les plaies pendant deux à quatre semaines. Durant toute cette période, l’individu infecté est à même de contaminer d’autres personnes. Le traitement peut cependant raccourcir la période, car il empêche l’agent pathogène de se multiplier davantage.
Si les bactéries pénètrent dans le corps, le système immunitaire tente de les combattre. Ceci provoque souvent une fièvre, laquelle signale une infection.
Les bactéries produisent également une toxine (toxine diphtérique) et la libèrent dans le corps. Le poison affecte de nombreux processus dans le corps et entraîne ainsi l’apparition des symptômes caractéristiques de la diphtérie.
Comment le médecin diagnostique-t-il la diphtérie ?
Afin de diagnostiquer clairement la diphtérie, une discussion approfondie avec le médecin (anamnèse) est essentielle. Il est important de décrire tous les symptômes, leur ancienneté et leur intensité. Il est également conseillé de mentionner tout voyage de vacances récent, car certains pays appliquent des normes d’hygiène moindres et l’infection par la bactérie diphtérique y est plus probable.
S’il suspecte un cas de diphtérie, le médecin effectuera le plus souvent un prélèvement. Celui-ci peut être réalisé dans la bouche ou la gorge, ou sur la plaie à l’origine de la maladie. L’écouvillon est généralement envoyé à un laboratoire et testé pour y détecter la bactérie diphtérique. On recherchera alors les bactéries elles-mêmes, ou bien uniquement leur matériel génétique, à l’aide de tests de biologie moléculaire tels que la PCR.
Comment le médecin traite-t-il la diphtérie ?
Pour traiter la diphtérie, on emploie généralement l’une de ces deux options :
-
1. Antitoxine (antidote)
La bactérie diphtérique libérant une toxine dans l’organisme, cette toxine doit être neutralisée grâce à un antidote approprié. Il est important que l’antidote soit administré le plus tôt possible, car ce n’est qu’alors qu’il sera efficace. Plus le poison reste longtemps dans le corps, plus il se lie aux cellules du corps et n’est alors plus en circulation libre, devenant difficile à intercepter avec l’antidote.
L’antidote est généralement injecté directement dans le muscle ou dans une veine.
Celui-ci étant principalement issu de chevaux, il contient souvent des substances spécifiques à l’espèce. Ces structures sont étrangères à l’homme, c’est pourquoi des réactions allergiques peuvent survenir suite à l’injection d’antidote. En règle générale, un test est effectué avant l’administration pour déterminer si une telle allergie existe. Dans la plupart des cas, le traitement est effectué dans le cadre d’une hospitalisation et l’état de santé du patient peut ainsi être surveillé en permanence.
2. Antibiotiques
Les antibiotiques sont généralement utilisés pour traiter les bactéries diphtériques elles-mêmes. Souvent de la classe des ß-lactamines ou des macrolides, comme la pénicilline et l’érythromycine, les antibiotiques provoquent la mort des bactéries, lesquelles ne sont plus capables de libérer leur poison.
Le plus souvent, les antibiotiques agissent rapidement. Après seulement quatre jours, la personne infectée cesse d’être contagieuse. Néanmoins, l’antibiotique est prescrit durant 14 jours afin de garantir que tous les agents pathogènes soient détruits.
S’il existe une diphtérie cutanée, les antibiotiques sont généralement suffisants. L’infection n’étant souvent que superficielle, aucune antitoxine ne doit alors être administrée.
Que pouvez-vous faire si vous avez la diphtérie ?
Si vous souffrez de diphtérie, il est conseillé de suivre les instructions du médecin et de prendre l’antibiotique comme indiqué.
Les individus malades sont généralement isolés. Si vous pensez être atteint de diphtérie, il est conseillé de limiter au maximum les contacts avec d’autres personnes.
En outre, il existe une obligation de déclarer tous les cas de diphtérie aux autorités sanitaires compétentes dans toute l’UE et en Suisse. Cette déclaration est généralement effectuée par le médecin.
Il existe un vaccin contre la diphtérie, lequel permet de prévenir toute évolution sévère de la maladie. Le vaccin contient une forme affaiblie de la toxine diphtérique, rendue inoffensive pour l’homme. Avec la vaccination, le corps reconnaît toujours la structure du poison et forme des anticorps, mais n’est pas infecté par la diphtérie.
Cependant, comme le vaccin ne cible que la toxine et non la bactérie elle-même, la contagion reste possible. Dans la plupart des cas cependant, les attaques de cette bactérie peuvent être surmontées sans complications graves.
Le vaccin n’est néanmoins efficace que contre la toxine de la bactérie C. diphtheriae et non contre C. ulcerans et C. pseudotuberculosis. Mais en raison de la similitude des agents pathogènes, on suppose que la vaccination protège également contre ces agents pathogènes ou leurs toxines (immunité croisée).
La vaccination contre la diphtérie est aujourd’hui proposée en combinaison avec les vaccinations contre le tétanos (tétanos) et la coqueluche (coqueluche). Les bébés sont souvent vaccinés dès l’âge de deux mois dans le cadre du programme de l’immunisation de base. Pour une protection complète, la vaccination est généralement répétée à quatre et onze mois. Il est ensuite nécessaire de renouveler le vaccin tous les dix ans pour le reste de la vie.
Survivre à la maladie ne conduit pas à une immunité à vie : une réinfection reste possible. Pour cette raison – et pour prévenir tout autre type d’infection -, il est recommandé d’instaurer une hygiène et une désinfection de qualité.
La vaccination est obligatoire en Italie et en France, recommandée en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en Suisse.
Publié le : 06.08.2025
____________________________________________________________________________________________________________________________
Notre contrôle de qualité

"Nous attachons beaucoup d'importance à fournir des informations variées et détaillées. Nos conseils santé, rédigés par notre équipe d'experts, nous permettent de transmettre nos connaissances pharmaceutiques et d'aider nos clients à résoudre leurs problèmes."
Claudia Manthey soutient notre entreprise depuis 15 ans en tant que Senior Project Operations Manager. En qualité de pharmacienne assistante technique, garantir la qualité pharmaceutique de Redcare Pharmacie lui tient à cœur. Grâce aux conseils santé, nous transmettons à nos clients des connaissances approfondies sur différents sujets de santé.







